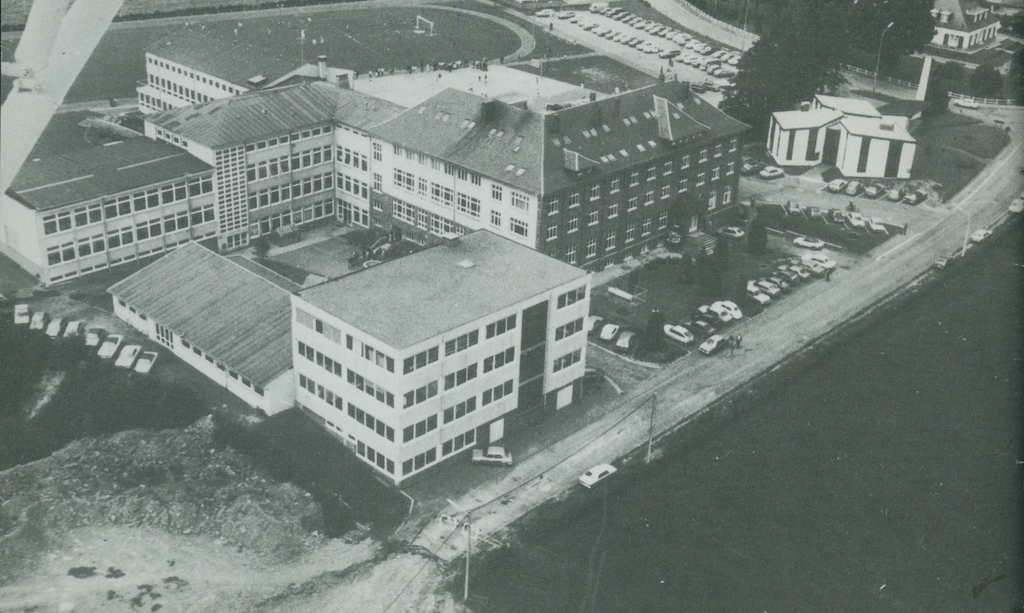Au cours du 19ᵉ siècle, la Belgique s’était rapidement transformée en un État central unitariste. Après 1945, ce n’était plus qu’un mirage. Une classe supérieure francophone dominait l’État, et les populations wallonnes et francophones profitaient de leur connaissance de la langue de l’État. La majorité flamande réclamait davantage de droits culturels et linguistiques. C’est ainsi que la résistance à l’État central s’est accrue.
Le pays était donc sensiblement en effervescence depuis les années 1950. En 1948, on créa un centre d’études, nommé d’après l’homme politique belge Pierre Harmel. Il élabora jusqu’en 1955 un rapport sur les problèmes nationaux, qui fut adopté en 1958. Résultat : en 1962, un texte de loi fixa les frontières linguistiques et, un an plus tard, l’usage des langues dans l’enseignement. Cela donna également naissance à un territoire officiel de langue allemande en Belgique, qui comprenait les neuf communes germanophones actuelles. Désormais, chaque germanophone pouvait théoriquement revendiquer son droit à communiquer avec les autorités publiques dans sa langue maternelle. Dans la pratique, il a toutefois fallu de nombreuses années pour que ce droit soit appliqué de manière générale. Parallèlement, la minorité a pris conscience de ses droits au sein de l’État.
Les actuelles communes de Malmedy et Waimes font depuis lors partie du territoire de langue française. La décision d’appartenance était prise par les conseils communaux respectifs. Dans la commune de La Calamine, cette décision fut prise de justesse, avec une seule voix de majorité en faveur du territoire de langue allemande.
Mais les lois linguistiques n’étaient qu’une première étape. Le mouvement flamand ne réclamait pas seulement des droits linguistiques dans l’enseignement, dans l’administration et devant les tribunaux, mais aussi davantage de participation politique. Ils se considéraient comme défavorisés. Seuls les étudiants des Cantons de l’Est à Louvain, en Flandre, ont vécu de près les grandes tensions entre francophones et Flamands. Dans les Cantons de l’Est, les vives tensions internes à la Belgique dans les années 1960 ont été à peine évoquées dans la presse. Ces débats sur l’autonomie ont en partie submergé la minorité, qui avait été tiraillée au cours de l’histoire et qui a dû se positionner dès la fin des années 1960.
L’historien se trouve confronté aux questions suivantes : les germanophones ont-ils réellement lutté pour leur autonomie ? Ou est-elle le résultat secondaire des tensions entre les deux grands ‘groupes ethniques’ de Flamands et de Wallons ? Quels groupes d’intérêts ont déterminé cette entente démocratique et avec quels objectifs ?
Un regard rétrospectif :
- Les deux décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été marquées par une forte dépolitisation de la vie publique dans les Cantons de l’Est. Symptomatique de cette dépolitisation était le dicton selon lequel les habitants des Cantons de l’Est ne voulaient même plus devenir membres de l’association du Sacré-Cœur. Ce comportement faisait partie de l’omerta collective.
- L’opinion publique était déterminée par un journal en situation de monopole, le Grenz-Echo. Il était le porte-parole du Parti chrétien-social (PCS). Ce parti bourgeois conservateur faisait presque toujours partie de la coalition gouvernementale au Parlement à Bruxelles. Le CSP dominait la vie politique locale : Entre 1946 et 1965, entre 93 et 69 % des électeurs des Cantons de l’Est votèrent pour ce parti. Le Parti chrétien-social était considéré comme « le parti des Cantons de l’Est ».
- Administrativement, la région a été gérée par le commissaire d’arrondissement adjoint Henri Hoen entre le 15 janvier 1945 et le 1ᵉʳ décembre 1976. Jusque dans les années 1960, il tenta de mettre en œuvre les orientations politiques formulées en 1946 par le gouvernement belge, à savoir la fermeture de la frontière belgo-allemande sur une grande partie du territoire et l’orientation des germanophones vers l’intérieur du pays, la diffusion d’un nationalisme belge et la promotion de la langue française dans l’administration et l’enseignement. Certains critiquaient le fait que cela se faisait au détriment de la langue allemande, tandis que d’autres voyaient des avantages dans une société ayant une connaissance avancée de l’allemand et du français.
- Certains Belges germanophones avaient le sentiment que les possibilités d’ascension économique en Belgique leur étaient refusées. L’Eifel belge était en outre une région structurellement faible. Le secteur agricole était en déclin. Les emplois alternatifs étaient insuffisants. L’émigration était élevée et le développement économique était très faible.
Les travaux de recherche réalisés jusqu’à présent font état de césures et de tournants dans les années 1960. Ceux-ci étaient d’ordre générationnel, car de jeunes politiciens ont apporté une nouvelle qualité au débat ; d’ordre social, car c’est précisément à ce moment-là que le désavantage des zones rurales et de la minorité est devenu particulièrement évident ; d’ordre politique, car la domination du PCS était devenue à ce point importante qu’elle a littéralement provoqué des réactions.
La mémoire communicative est peu à peu complétée par une mémoire culturelle, qui évoque, voire thématise, les traumatismes sociaux liés à la Première et à la Seconde Guerre mondiale :
- De nouvelles sociétés d’histoire voient le jour à Saint-Vith, Eupen et La Calamine.
- De jeunes universitaires allemands et suisses se penchent sur les changements d’États de 1920 à 1945 ainsi que sur la période de l’entre-deux-guerres et de la guerre.
- La radio belge (BHF) diffuse une série sur les « 50 ans des Cantons de l’Est ».
- Les premiers travaux historiographiques de la région sont publiés.
Dans les années 1960, une lente « pluralisation de la diversité des opinions » voit le jour : la Aachener Volkszeitung publie un supplément quotidien consacré aux Cantons de l’Est (1965-1989) ; le rédacteur en chef du Grenz-Echo Henri Michel est remplacé par Heinrich Toussaint, qui laisse nettement plus de place aux autres opinions ; le Belgische Hörfunk, émissions en langue allemande, élargit son programme et contribue à influencer les opinions.
Jusqu’en 1965, le Parti chrétien-social (« Christlich-Soziale Partei », CSP) était le seul porte-parole des Cantons de l’Est à Bruxelles. La léthargie de l’après-guerre a été rompue pour la première fois lors de la campagne électorale de 1968. Le parti libéral (PFF) obtint un tiers des voix après une campagne électorale remarquablement moderne. Le PCS n’atteignit que de justesse la majorité absolue. D’un point de vue actuel, de nombreuses voix n’étaient probablement pas tant un vote pour le parti libéral qu’une expression d’une protestation sociétale que le sénateur Michel Louis (PFF) de Saint-Vith, désormais coopté, rapporta à Bruxelles. Il s’engagea intrépidement pour la reconnaissance des germanophones en tant que minorité et pour l’autonomie. C’est ainsi que les Cantons de l’Est s’engagèrent activement et de manière controversée dans la politique.
Le changement général des valeurs modifia la société, le quotidien et la façon d’utiliser les médias. De nouveaux modèles de cohabitation virent le jour, considérablement renforcés par la démocratisation de l’enseignement. De plus en plus de citoyens osaient participer à la vie politique. La vie publique commença à se politiser à nouveau.
Le premier groupement politique régional créé en 1970 fut la Christlich-Unabhängige Wählergemeinschaft (CUW), qui devint en 1971 le Parti des Belges germanophones (PDB). Les porte-paroles étaient de jeunes politiciens qui avaient découvert, avant tout à Louvain, les visions flamandes de l’autonomie et du fédéralisme. Ils posaient des exigences maximales dans les débats sur l’autonomie. Face à eux se trouvaient les partis dits traditionnels. Une minorité de politiciens déjà établis s’opposait à toute transformation de l’État belge. La majorité de ces partis observaient plutôt le processus avec méfiance. Après une longue hésitation, ils misaient sur une politique à petits pas en alliance avec leurs partis mères nationaux. « Ostbelgien » parlait politiquement à plusieurs voix.
Au sein des partis belges, l’idée s’était imposée que seules des réformes profondes pouvaient sauver la Belgique au niveau national. Une autonomie culturelle des communautés linguistiques devait être une première étape. Ceci devait permettre d’atténuer la pression politique exercée par les Flamands fédéralistes sur l’État. La première réforme de l’État (1970/1971) déboucha sur la création des communautés culturelles néerlandaise, française et allemande.
L’autonomie de la minorité germanophone débuta le 23 octobre 1973 avec la mise en place du Conseil de la communauté culturelle allemande. Celui-ci fut le premier conseil culturel à être élu directement et librement dès 1974. Les conseils culturels flamand et français ont certes été mis en place dès 1971. Mais ce n’est qu’avec la quatrième réforme de l’État de 1993 que l’élection directe fut instaurée. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fut élu directement dès sa création en 1989.
En 1974, le Conseil de la Communauté culturelle allemande gérait un budget équivalent à 300.000 euros. Il ne disposait que de peu de pouvoirs. Cependant, pour les citoyens intéressés par la politique, il était le symbole de la reconnaissance tant attendue de la minorité germanophone avec sa langue, son histoire et sa culture. En tant que forum politique, il devait contribuer de manière décisive aux discussions sur l’autonomie et à l’organisation du processus d’autonomie à Eupen et à Bruxelles.
En 1950, il existait différentes visions de l’avenir pour les Cantons de l’Est : Une région où la langue française dominait à l’école, dans l’administration et dans la vie quotidienne. Ou une région dans laquelle la langue maternelle et la culture allemandes étaient reconnues et où les droits de participation aux décisions étaient possibles.